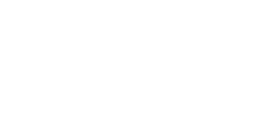La réhabilitation de Joyce Tunda Chansa comme maire intérimaire de Lubumbashi, en remplacement de Patrick Kafwimbi Mumamba, a mis le feu aux poudres.
Derrière cette tension politique, c’est tout le débat sur la méritocratie, la représentativité et la gouvernance locale qui ressurgit dans la capitale cuprifère du Haut-Katanga.
Un acte légal, une légitimité contestée
La décision du Conseil d’État de rétablir Joyce Tunda Chansa dans ses fonctions, après plusieurs mois de bataille administrative, aurait pu clore un contentieux.
Elle a, au contraire, rouvert une plaie politique et sociale.
Dans les rues de Lubumbashi, des jeunes regroupés au sein de l’association Sempya (ou Sympia) ont érigé des barricades et dénoncé ce qu’ils qualifient de « mépris des peuples autochtones », exigeant le maintien de Patrick Kafwimbi.
Ce qui devait relever du droit administratif s’est mué en contestation populaire, symbole d’une fracture croissante entre les institutions et une partie de la population.
La gouvernance locale en question
Dans le contexte congolais, la nomination d’un maire n’est jamais un simple acte administratif.
À Lubumbashi, la confrontation Tunda–Kafwimbi cristallise un malaise profond : celui d’une gouvernance perçue comme soumise aux influences partisanes.
Les critères de compétence et d’expérience semblent relégués au second plan, au profit des affinités politiques.
Cette logique d’appareil, dénoncée depuis des années, fragilise la crédibilité des institutions locales et nourrit un sentiment d’exclusion parmi les jeunes et les communautés de base.
Pour beaucoup, la décision du Conseil d’État, bien que juridiquement fondée, obéirait davantage à des équilibres politiques qu’à une évaluation objective du mérite administratif.
Quand les associations culturelles deviennent des acteurs politiques
La mobilisation de Sempya, à l’origine une structure socio-culturelle, illustre la porosité entre société civile et champ politique.
Créées pour promouvoir la culture et la cohésion communautaire, ces associations s’impliquent de plus en plus dans les affaires publiques, souvent pour défendre des intérêts identitaires.
À Lubumbashi, Sempya s’est transformée en véritable acteur politique, mobilisant ses membres et menaçant de durcir le ton.
Si cette implication traduit une vitalité citoyenne, elle comporte un risque : celui de la politisation des appartenances culturelles, qui peut fragiliser la cohésion sociale et transformer les institutions locales en champs de bataille communautaires.
Ce qui se joue dans la capitale du cuivre dépasse la rivalité entre deux cadres administratifs.
La crise actuelle reflète un déséquilibre plus large : centralisation excessive, influence des partis sur les nominations locales, et opacité dans les décisions publiques.
En toile de fond, une question essentielle : la décentralisation congolaise est-elle encore réelle, ou reste-t-elle une fiction sous la tutelle du pouvoir central ?
Lubumbashi, moteur économique du Haut-Katanga, se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins.
Des conséquences lourdes pour la ville
Les effets de la crise ne se font pas attendre.
Les manifestations ont paralysé plusieurs zones, les services municipaux tournent au ralenti, et l’incertitude administrative gagne les agents locaux.
Cette défiance croissante vis-à-vis des dirigeants affaiblit la gouvernance urbaine, tandis que le climat d’instabilité risque de décourager les investisseurs.
L’affaire Joyce Tunda n’est donc pas qu’un épisode de plus dans les turbulences politiques congolaises : elle révèle un malaise institutionnel profond, où les décisions de justice se heurtent à la réalité du terrain.
Au-delà de Lubumbashi, le miroir d’un pays
Sous la présidence de Félix Tshisekedi, la promesse d’une gouvernance fondée sur la justice, la compétence et l’unité nationale semble s’éroder.
Partout, les nominations et réhabilitations sont perçues comme des récompenses partisanes, non comme des choix de compétence.
Ce favoritisme institutionnalisé nourrit la méfiance et fracture la nation.
En privilégiant les équilibres ethno-politiques au détriment du mérite, le pouvoir reproduit les travers qu’il prétendait combattre.
La RDC ne se relèvera pas par les appartenances, mais par la méritocratie, l’éthique et la transparence.
Tant que le tribalisme servira de boussole au sommet de l’État, chaque nomination — qu’elle soit à Kinshasa, Goma ou Lubumbashi — restera une étincelle dans une poudrière nationale.
Lubumbashi, aujourd’hui en ébullition, n’est pas une exception.
Elle est le miroir d’un pays en quête de justice républicaine, loin des loyautés de clans et des calculs politiques.
Le véritable chantier du pouvoir Tshisekedi devrait commencer ici : par la désintoxication de l’État du poison du tribalisme.