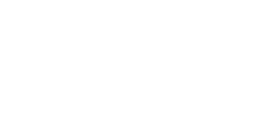La protection des citoyens et de leurs biens constitue le fondement même de l’autorité de l’État. Elle est, en principe, non négociable. Pourtant, à Kinshasa, ce principe semble se dissoudre dans le quotidien d’une population de plus en plus livrée à elle-même. L’insécurité, loin d’être un phénomène isolé ou conjoncturel, s’installe progressivement comme une réalité ordinaire, au point de susciter une inquiétude profonde au sein de l’opinion publique.
Dans la capitale congolaise, les enlèvements se multiplient selon des schémas presque identiques : rapt ciblé, demandes de rançons élevées, pressions psychologiques sur les familles et, désormais, mise en scène de la souffrance des victimes sur les réseaux sociaux. Ces pratiques, qui relèvent d’une criminalité organisée classique, donnent pourtant l’impression de prospérer sans réelle entrave, comme si les institutions chargées de la sécurité évoluaient à contretemps ou manquaient de solutions.
Les familles kinoises vivent désormais dans l’angoisse permanente de voir un proche disparaître. Rares sont les semaines qui ne soient marquées par un nouveau cas, souvent relayé dans les quartiers, les églises ou sur les plateformes numériques. Plus troublant encore, les ravisseurs semblent agir avec une assurance déconcertante, allant jusqu’à diffuser des images de torture pour accélérer le paiement des rançons, dans une logique de terreur assumée.
Cette situation interroge frontalement l’usage réel des capacités de l’État. Dans un pays qui revendique des avancées en matière de gouvernance numérique et de technologies de communication, comment expliquer une telle difficulté à identifier, localiser et neutraliser des réseaux criminels qui négocient ouvertement par téléphone et par voie électronique ? À quoi servent les services de renseignement et les outils technologiques, s’ils ne sont pas prioritairement mobilisés pour protéger les citoyens ordinaires ?
Les faits récents illustrent crûment cette faillite perçue du dispositif sécuritaire. L’enlèvement de Nahomie Kayi, mère de famille vivant à Ngiri-Ngiri, a profondément choqué l’opinion. Kidnappée en pleine journée alors qu’elle vaquait à ses occupations quotidiennes, elle n’a dû sa survie qu’au paiement d’une rançon exigée sous la menace explicite de mort, après diffusion de photos humiliantes et traumatisantes. Elle a été retrouvée quelques jours plus tard, vivante mais profondément marquée, dans une autre commune de la ville.
D’autres affaires similaires ont précédé ou suivi ce drame : étudiants, jeunes travailleurs, anciens universitaires, tous pris pour cibles, tous libérés après versement d’argent, sans que l’opinion ne perçoive de réponses fortes ou dissuasives de la part des autorités compétentes. Cette répétition nourrit un sentiment d’abandon et renforce l’idée que le système sécuritaire peine à remplir sa mission, engageant directement la responsabilité politique du ministère de l’Intérieur.
Dès lors, une question obsède les esprits : combien de vies faudra-t-il encore exposer avant qu’une réaction ferme et structurée ne soit engagée ? Combien d’enlèvements, aux côtés d’autres formes de criminalité, devront encore endeuiller ou traumatiser des familles pour que la sécurité cesse d’être un simple slogan institutionnel ?
À l’ère de la géolocalisation, des bases de données numériques et des partenariats avec les opérateurs de télécommunications, l’impuissance affichée face à des criminels identifiables surprend autant qu’elle inquiète. La lutte contre l’insécurité ne peut rester sélective ni circonstancielle. Elle exige une volonté politique claire, une mobilisation réelle des moyens technologiques et une priorité absolue accordée à la protection de la population.
À Kinshasa, l’urgence n’est plus à la communication, mais à l’action. Car un État qui ne rassure plus ses citoyens finit, tôt ou tard, par perdre leur confiance.