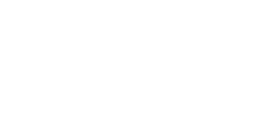En rendant hommage à Mgr Christophe Munzihirwa, 29 ans après son assassinat, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué la mémoire d’un « homme de vérité, de paix et de justice ». Un message adressé aux populations du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, aujourd’hui sous contrôle de l’AFC/M23.
Mais derrière l’émotion présidentielle, une question dérange : que reste-t-il réellement de l’héritage de Munzihirwa dans l’action concrète du pouvoir en place ?
Le chef de l’État dénonce régulièrement les « mouvements d’agression », qualifiés de « rébellions téléguidées par Kigali », tout en refusant tout dialogue avec « les émissaires des agresseurs », au nom de la souveraineté. Pourtant, l’Église que représentait Munzihirwa plaidait pour le dialogue, la désescalade et la réconciliation.
Tshisekedi peut-il, dans la même phrase, invoquer Munzihirwa et rejeter toute voie politique de sortie de crise ? Peut-on se réclamer d’un archevêque tombé pour la paix tout en tenant un discours de fermeture, souvent plus symbolique qu’efficace ?
Alors que les populations de Goma, Rutshuru ou Masisi continuent de fuir, et que les affrontements se poursuivent entre l’armée congolaise et les groupes armés notamment l’AFC/M23, les hommages présidentiels peuvent sonner comme un aveu d’impuissance.
Rappeler Munzihirwa, c’est rappeler l’exigence morale : celle d’une vérité sans tri, d’une paix sans calcul, d’une justice équitable. Il ne suffit pas de citer les martyrs, il faut les incarner.
D’où la pertinence de la démarche initiée par les pères des Églises catholique et protestante, en faveur d’un dialogue inclusif national, tel que prôné par plusieurs forces politiques et sociales. Cette initiative reste, à ce jour, la seule voie de sortie crédible face à la crise actuelle.