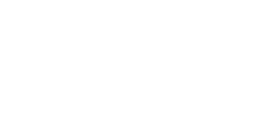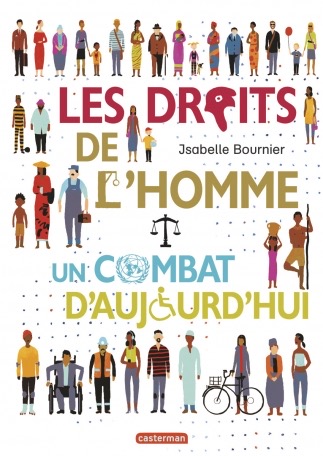Trente années de violence et d’instabilité
Depuis plus de trois décennies, l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) vit au rythme des conflits armés.
Entre les groupes rebelles locaux et les forces étrangères impliquées dans la lutte pour le pouvoir, la terre et les ressources naturelles, la population paie un lourd tribut.
Dans cette partie du pays, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, parler de respect des droits humains relève presque de l’utopie.
Les droits humains face à deux feux croisés
Depuis plusieurs années, la RDC fait face à la multiplicité des groupes rebelles.
Parmi eux, l’ADF, groupe d’origine étrangère actif dans le nord de la province du Nord-Kivu et en Ituri, et le M23, un mouvement rebelle congolais soutenu par le régime rwandais, qui contrôle une grande partie du Nord et du Sud-Kivu.
Les violations des droits humains sont documentées des deux côtés, aussi bien dans les zones sous contrôle rebelle que dans celles tenues par les forces régulières.
« Nous recevons souvent des alertes sur des cas d’arrestations arbitraires, de tortures, de tueries, de viols et de pillages. Dans les zones contrôlées par les éléments du M23, l’enrôlement forcé des jeunes est fréquent »,
explique Jules Ngeleza, défenseur des droits humains contacté par Actu26.
Mais le constat ne s’arrête pas là.
« Même du côté de l’armée, certains éléments des FARDC et des Wazalendo commettent des abus : viols, tracasseries et pillages, en violation des ordres du commandement », poursuit-il.
La population prise en étau
Dans cette réalité marquée par les affrontements et les exactions, les civils sont les principales victimes.
« Aucun respect des droits humains n’est possible dans un tel contexte. La population est prise en étau entre les deux parties »,
déplore Jules Ngeleza, qui suit de près la situation dans le Nord-Kivu.
Ce que disent les textes fondamentaux
La Constitution congolaise de 2006 garantit à chaque citoyen le droit à la dignité, à la vie et à l’intégrité physique.
Elle interdit la torture, l’esclavage et le travail forcé, tout en garantissant les libertés fondamentales.
Ces dispositions sont renforcées par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) des Nations unies, qui stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Pourtant, sur le terrain, ces principes semblent inapplicables dans un climat de guerre.
La paix, condition du respect des droits humains
Pour Jules Ngeleza, la clé du respect des droits humains réside avant tout dans la fin des hostilités.
« Ce qu’il faut, c’est mettre fin aux conflits armés. Nous soutenons le gouvernement et ses partenaires dans les processus de paix. C’est seulement après la restauration de la paix que les textes sur les droits humains pourront s’appliquer »,
affirme-t-il.
Défendre les droits dans un contexte d’insécurité
L’Est du pays est marqué par les déplacements massifs de populations et une insécurité généralisée.
Cette situation limite la liberté d’action des défenseurs des droits humains (DDH).
« Beaucoup d’entre nous subissent des intimidations, des arrestations ou des menaces lorsqu’ils dénoncent les violations ou soutiennent les victimes »,
s’inquiète Kambale Nguka Patrick, coordinateur de l’ONG BADILIKA.
Certains défenseurs sont contraints de vivre dans la clandestinité, surtout ceux qui dénoncent les exactions des groupes armés ou les abus de certains agents de l’État.
Les défis des défenseurs des droits humains
Outre les menaces physiques et judiciaires, les DDH se heurtent à un manque de moyens financiers et logistiques.
Ils évoquent aussi l’absence d’un mécanisme efficace de protection, les difficultés d’accès aux zones de guerre, et la méfiance de certaines autorités.
« La précarité est notre quotidien. Pourtant, nous continuons notre combat, car le silence aggrave la souffrance »,
témoigne un défenseur sous anonymat.
Conditions de vie et résilience
Les DDH de l’Est vivent dans des conditions sociales très difficiles.
Privés d’emplois stables, beaucoup survivent grâce à de petites activités génératrices de revenus.
Malgré tout, leur résilience reste admirable : ils poursuivent leur mission de dénonciation, au péril de leur vie.
Plaidoyer pour une meilleure protection
Les acteurs des droits humains estiment que le respect des droits fondamentaux et la protection de ceux qui les défendent doivent aller de pair.
Ils formulent plusieurs recommandations :
- La restauration de la paix dans les zones de conflit ;
- La sécurité et la protection effective des défenseurs des droits humains ;
- Une collaboration sincère entre les autorités et la société civile, sans intimidations ;
- Le respect des libertés d’expression et d’association ;
- L’amélioration des conditions socio-économiques des populations déplacées et victimes de guerre.